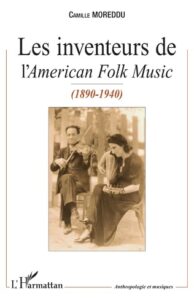 Les inventeurs de l’American Folk Music (1890-1940)
Les inventeurs de l’American Folk Music (1890-1940)
Paris, L’Harmattan, 2022, 433 p.
Les chiffres entre parenthèses renvoient à des notes en fin de document.
Chronique de Gérard De Smaele
Les Etats-Unis s’attachent particulièrement bien à protéger leur patrimoine musical traditionnel, à l’étudier et à le mettre en perspective. A ce sujet, de nombreuses universités et bibliothèques américaines conservent jalousement d’importants fonds documentaires et ont publié d’abondantes études menées par leurs chercheurs.
A la Library of Congress (American Folklife Center) et à la Smithsonian Institution (Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, The Ralph Rinzler Archives et chez Smithsonian Folkways Records) on ajoutera encore quelques autres exemples notoires, comme The University of Illinois Press, The University of North Carolina Press, The Harvard University Press, The University of Tennessee Press, etc… dont l’inventaire complet serait long à énumérer (1).
Les auteurs prenant part à ces éditions sont des enseignants ou des chercheurs indépendants qui, plus souvent qu’on ne l’imagine, mettent la main au portefeuille afin de se voir publiés (2) . C’est parfois le prix à payer pour mener à bien une carrière académique.
On se rendra aussi compte que l’enjeu intellectuel, social ou politique de ces écrits déborde largement du strict cadre musical. Pour nous, ils soulèvent la question de savoir ce que nous pouvons apprendre d’une société à travers les signaux qu’elle émet et de quelle utilité sociale, voire militante ce savoir est porteur. Sur cette terre, partout où se rassemblent les hommes, la musique fédère et la tentation est grande de s’en servir à toutes sortes de fins.
En langue française, les ouvrages -universitaires ou pas-, traitant de l’american folk music, se font beaucoup plus rares. Pour mémoire, l’américain Josiah Comb vint en 1925 défendre à La Sorbonne une thèse de doctorat intitulée Folk Songs du Midi des Etats-Unis (Paris : Presses Universitaires de France, 1925).
A la même époque l’ethnomusicologue français André Schaeffner (1895-1980), qui deviendra par la suite maître de recherche au CNRS et chef de département au Musée de l’Homme, publiera dans Le Ménestrel divers articles sur les racines africaines du jazz.
Plus proche de nous, citons quelques auteurs contemporains qui ont marqué le public francophone, comme Jacques Vassal, Jacques Bremond, Gérard Herschaft ou Etienne Bours (3), par ailleurs auteur de nombreux articles de fond publiés dans l’excellente revue Trad Mag, récemment renommée et diffusée sur internet sous le titre de Cinq Planètes (4).
Pour finir, n’oublions pas de mentionner un dernier exemple avec Michel Oriano et son Bûcherons, cow-boys, cheminots américains du XIXe siècle (Paris: Payot, 1980).
Camille Moreddu est docteure en histoire contemporaine (Université de Paris-Nanterre). En 2022, elle a effectué un post-doctorat de huit mois à la Bibliothèque du Congrès à Washington (a Jon B Lovelace Fellowship for the Study of the Alan Lomax Collection).
 Ses recherches portent sur l’invention aux Etats-Unis de la catégorie musicale « folk music », de la fin du XIXe siècle à 1940. A l’instar de Françoise Lempereur, l’ethnomusicologue belge spécialiste de la transmission du patrimoine culturel immatériel, partie dans les années 1970 à la rencontre des wallons du Wisconsin, elle s’intéresse actuellement à l’histoire des collectes de musiques franco-américaines dans le Midwest.
Ses recherches portent sur l’invention aux Etats-Unis de la catégorie musicale « folk music », de la fin du XIXe siècle à 1940. A l’instar de Françoise Lempereur, l’ethnomusicologue belge spécialiste de la transmission du patrimoine culturel immatériel, partie dans les années 1970 à la rencontre des wallons du Wisconsin, elle s’intéresse actuellement à l’histoire des collectes de musiques franco-américaines dans le Midwest.
Son dernier livre, Les Inventeurs de l’American Folk Music (1890-1940), paru aux éditions L’Harmattan en 2022, est une somme qui, pour une édition française, présente le mérite d’entrer dans les moindres détails du sujet, celui des coulisses de la recherche et des institutions chargées de les traiter.
 Il répond à la question de savoir quelles étaient leurs véritables motivations, notamment les initiatives politiques liées à la consolidation d’une identité nationale.
Il répond à la question de savoir quelles étaient leurs véritables motivations, notamment les initiatives politiques liées à la consolidation d’une identité nationale.
S’attarder sur la méthodologie de cette thèse nous mènerait fort loin. Voici donc la quatrième de couverture. Elle expose clairement le sujet de l’ouvrage :
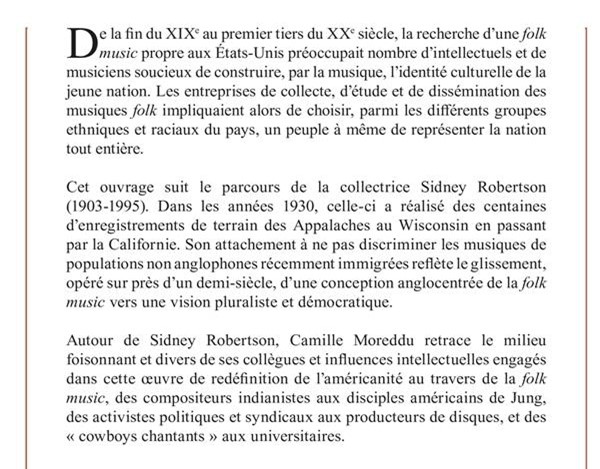
S’il est un fait que l’american folk music est une notion entourée d’un tas de mythes et d’aménagements de la réalité, on constate d’autre part que la musique et la chanson traditionnelle des américains font surtout référence à des sources anglo-saxonnes héritées des premiers colons.
Celles-ci peuvent faire l’impasse sur l’apport majeur des Afro-Américains (12% de sa population), ainsi que sur d’autres nationalités, qui au cours de différentes vagues d’immigration ont finalement modifié la part de représentation de ces nouveaux arrivants. Qu’ils soient chinois, espagnols, juifs, polonais, mexicains, français ou allemands…. Ces différentes communautés ont aussi continué à se rassembler autour de musiques pouvant les reconnecter à leurs racines.
Et que dire des populations autochtones, ou plus exactement de ce qu’il en reste ? De toute évidence, les USA sont un creuset de cultures, dans une configuration et une perception qui a évolué avec le temps.
En fin de compte et dans ce contexte il serait bien à propos de clarifier ce qu’en réalité le terme ’American Folk Song’ signifie, tout comme d’ailleurs l’américanité.
En plus d’avoir édité l’ Anthology of American Folk Music, compilée par le collectionneur de 78 tours Harry Smith (Folkways Records, 1952) , ainsi que tant d’autres enregistrements de la même veine, Moses Asch (1905-1986), fondateur de la maison de disques Folkways Records – pérennisée de nos jours sous le label Smithsonian-Folkways- s’est intéressé aux musiques traditionnelles du monde entier. Toutes se devaient d’être authentiques, mais furent aussi enregistrées au sein de communautés d’immigrés établies aux USA.
Dans un autre registre que celui de Harry Smith, l’abondante collection de 78 tours rassemblée par Pat Conte abonde dans le même sens que Moses Asch ‘(5), et témoigne elle aussi de l’attachement des immigrés à leurs racines.
N’empêche que si les mythes entourant la musique américaine se sont construits sur des bases réelles, ils en déforment aussi, dans une certaine mesure, la réalité, d’autant plus qu’ils ont été utilisés afin de servir des initiatives visant à renforcer le sentiment d’appartenance à l’identité nationale.
 Aux USA, si l’industrie du disque florissante dans des années 1920 et 1930 avait un objectif commercial, des instances officielles soutenant les recherches des ethnomusicologues, ont ensemble ouvertement œuvré à travers la musique à renforcer un sentiment d’appartenance à la nation.
Aux USA, si l’industrie du disque florissante dans des années 1920 et 1930 avait un objectif commercial, des instances officielles soutenant les recherches des ethnomusicologues, ont ensemble ouvertement œuvré à travers la musique à renforcer un sentiment d’appartenance à la nation.
Politiquement parlant, et pour pouvoir faire face à une éventuelle adversité, n’était-il pas nécessaire de pouvoir rassembler autour d’un même drapeau les forces vives du pays : « l’union fait la force! » dirions-nous, en oubliant pour la bonne cause toutes les injustices sociales, qui deviendront par la suite -dans la foulée d’un Pete Seeger ou d’un Woody Guthrie-, un des grands leitmotivs du folk revival. C’est là que l’on retrouve l’utilité et l’engagement social, aussi bien des artistes que des chercheurs, comme par exemple Dena Epstein, Cecelia Conway (6) ou Bob Winans, Laurent Dubois…
 En plus d’être juste et précis, ce livre de Camille Moreddu a pour nous toutes les vertus d’une version originale pensée et écrite en français. Elle représente, à notre avis, le premier texte en français qui fasse une synthèse aussi documentée et réfléchie concernant les enjeux de l’invention de l’american folk music.
En plus d’être juste et précis, ce livre de Camille Moreddu a pour nous toutes les vertus d’une version originale pensée et écrite en français. Elle représente, à notre avis, le premier texte en français qui fasse une synthèse aussi documentée et réfléchie concernant les enjeux de l’invention de l’american folk music.
Gérard De Smaele, le 30.11.2023.
——————————————————————————
Notes
(1) Pour de plus amples informations, voir G. De Smaele, A Five-String Banjo Sourcebook ( Paris : L’Harmattan, 2019): www.desmaele5str.be/banjoAttitudes
(2) Pour prendre un exemple, l’édition de Banjo Roots and Branches, une publication dirigée par Robert Winans (Urbana: University of Illinois, 2018) a été financée par des fonds privés provenant de la succession de Schlomo Pestcoe.
(3) On notera entre autres ouvrages: Jacques Vassal. Folksong: Racines et branches de la musique folk des Etats-Unis. Paris : Albin Michel, 1971, 432 p. (nouvelle édition chez Les Fondeurs de Briques, en 2021 ; Jacques Bremond. Guide de la Country Music et du Folk. Paris : Fayard, 1999, 592 p. ; Gérard Herschaft. Americana: Histoire des musiques de l’Amérique du Nord. Paris : Fayard, 2005, 287 p. ; EtienneBours.Pete Seeger : un siècle en chansons. Editions Le Bord de l’Eau, 2010, 214 p. et Le sens du son :musiques traditionnelles et expression populaire. Paris : Fayard, 2007, 476 p
(4) fr.wikipedia.org/wiki/Trad_Magazine
(5) John Cohen. «Pat Conte Unearths ‘The Secret Museum of Mankind’. » Sing Out, Vol. 43/3, 1999, pp. 60-67.
(6) Dena Epstein. Sinful Tunes and Spirituals: Black Folk Music to the Civil War. University of Illinois Press, 2003, 464 p.; Cecelia Conway. African Banjo Echoes in Appalachia: A Study of Folk Traditions. Univ. of Tennessee Press, 1995 – 394 p.
Légende des photos:
“Presto direct disc cutting recorder” embarqué par Alan Lomax lors de “Fieldtrips” réalisés pour la Bibliothèque du Congrès, fin des années 1930 et début des années 1940. C’est un appareil dit portable mais encore très lourd. Aucune comparaison avec le Nagra qui apparaîtra dans les années 1950. Library of Congress, American Folklive Center. Photos: Gerard De Smaele 2022.
Camille Moreddu : Les inventeurs de l’American Folk Music (1890-1940)
L’Harmattan, Paris, 2022
————————————————————–
Chronique d’Etienne Bours.
Étant tout-à-fait en phase avec ce que Gérard De Smaele a écrit sur le livre de Camille Moreddu, je voudrais simplement ajouter deux ou trois considérations.
Cette musique folk américaine, nous l’avons découverte essentiellement grâce aux artistes du revival. Soit depuis les années 50 et 60.
Mais l’auteur nous parle de l’époque qui précède et ce à travers le travail de Sidney Robertson qui collecta énormément dans les années 30. Et qui travailla avec des personnages clés de cette histoire et de ces recherches ; notamment Charles Seeger et Alan Lomax (sans oublier son père John). Deux ou trois personnages que nos écoutes des artistes du revival nous firent rencontrer et apprécier.
Mais ce retour en arrière est bienvenu parce qu’il nous oblige à englober nos approches dans une analyse plus large.
Quelques simples exemples devraient suffire à prouver l’intérêt de cette lecture. Page 229, l’auteur écrit : « Robertson considère alors que pour définir ce qu’est l’american folk music il est nécessaire de prendre en compte l’opinion et les goûts des immigrants à qui s’adressent les programmes d’américanisation, car ils font eux aussi partie du peuple américain.
Cette vision rompt avec l’idée de pureté ethnico-raciale défendue par les experts baignant encore dans le courant du nationalisme culturel, comme avec une approche des minorités en tant que sujets passifs à intégrer ».
Voilà qui est essentiel évidemment. Car qui est ce folk, ce peuple, dont les expressions musicales pourraient être baptisées american folk music ? Pete Seeger, encore et toujours lui, n’a eu de cesse de s’intéresser aux chansons de toutes les communautés de son pays… Mais avant lui, on a souvent commis l’erreur de classer les choses avec une vue beaucoup trop nationaliste – mais quel nationalisme ?
L’auteur différencie bien divers courants ou approches. Les « antiquarians » ou ces folkloristes qui ont tendance à vouloir mettre les répertoires dans des musées ou sous cloches, tout en étant également capables de les réécrire. Cette manie de la réécriture existait aussi chez les romantiques qui ont œuvré aux États-Unis comme en Europe. Avec les mêmes qualités et les mêmes dérives.
L’auteur nous rappelle le travail de Cecil Sharp sur le continent américain. A ce stade, le livre me rappelle parfois l’excellent ouvrage de Georgina Boyes « The Imagined Village. Culture, ideology and the English folk revival » (Manchester University Press, 1993).
Non traduit mais qui vaut largement une lecture approfondie et une comparaison avec ce livre sur la musique américaine. Camille Moreddu termine sa conclusion en insistant sur l’américanité pluriculturelle : « le caractère folk n’est plus la supposée pureté raciale d’un groupe culturellement isolé, mais le résultat de contacts, d’évolution des répertoires au fur et à mesure que les populations s’américanisent ».
Voilà, comme l’écrit aussi Gérard, un livre à ne pas négliger…
Etienne Bours
(article paru dans le Canard Folk de janvier 2024)

