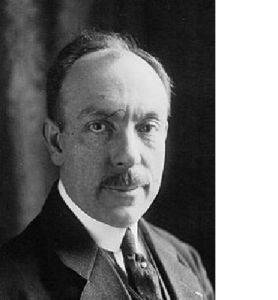
Marie-Louise Carels nous envoie quelques extraits du chapitre « bals et soirées » de l’ouvrage « Tranches de vie » de Michel Jans (éd. Mosquito, 1994) qui reprend des
textes d’ouvrages anciens sur le savoir-vivre, avec des illustrations de Fr. Margerin. En voici le dernier, de Paul Reboux, intitulé « La danse » et pas piqué des vers.
On peut diviser les danses en deux catégories : les danses vives et les danses lentes. Les unes et les autres sont d’un caractère indécent, parce qu’elles sont, les unes et les autres, le symbole des phases de l’amour : préambule, ou aboutissement. Les danses antiques exprimaient la joie de vivre et l’humeur belliqueuse. Dans le menuet, et la pavane, le couple observait d’honnêtes distances. Les danses collectives, telles que le quadrille, la contredanse, ou la tarentelle italienne étaient chastes. Les danses espagnoles, telles que la farruca, le classique boléro, la jota, la sévillana, ne pouvaient justifier de blâme. Mais nous avons changé tout cela.
Danses vives
Le fox-trot, lui, symbolise les préliminaires de la volupté. Il se rapproche assez exactement du frottifrotta pratiqué par les nègres. C’est le prétexte à un corps à corps rythmique, à une suite d’effleurements ou de compressions.
Il ne donne plus cette sorte d’enivrement léger que provoquait la valse, anesthésique des scrupules. Il prépare à cet aboutissement logique et naturel : le contact intime des corps. Si les gens dansaient avec sincérité, ce qui commença sur un parquet dur s’achèverait sur un divan moelleux.
Mais, comme on sait, la sincérité est très souvent en contradiction avec la bienséance. Voilà pourquoi la danse se pratique publiquement sans que la police ait à intervenir. Voilà pourquoi les mères, illusionnées ou inconscientes de l’agrément des danses nouvelles, regardent, d’un œil attendri piétiner leur progéniture.
Danses lentes
Le tango était à l’origine une très vieille danse espagnole, ardente et gaie, mêlée d’œillades, de caprices, de séductions. Puis, le tango est venu à Cuba.
Il s’est enflammé, sous le ciel tropical. Il a traversé ensuite le golfe du Mexique. Il est allé jusqu’en Argentine. Là, il a perdu tout ce qui lui restait de noblesse. Il devint la danse des crapules, la danse des couples ivres : femmes dont la besogne professionnelle ne saurait être honnêtement nommée, aventuriers, ruffians, pilleurs de troupeaux, métis déchus, mulâtres vicieux. ces filles à moitié saoules, ces gaillards portant deux revolvers en travers de la ceinture, serrés les uns contres les autres, formaient, dans le bouge mal éclairé, une sorte de gelée humaine se mouvant aux sursauts d’une musique pâmée.
Quand on a jugé le tango assez vulgaire, assez dégradé, assez repoussant, assez vil, assez immonde, on nous l’a amené en France.
Et vous savez avec quel enthousiasme il a été accueilli. Mais ce que les crapules des vilains quartiers de la Vera- Cruz, de Rio ou de Buenos-Ayres faisaient tout naturellement, nous l’avons transformé en une science. Et quelle science compliquée, quelle science transcendantale !
Le mouche tsé-tsé est une mouche petite et terrible. Lorsqu’elle a touché de son dard quelque nègre africain, elle lui inocule la maladie du sommeil. Eh bien ! je ne sais quelle mouche a piqué, voilà quelques années, nos danseurs. Quand débutait le tango, un mal bizarre semblait les avoir frappés. Le tango nous offrait le singulier spectacle de couples presque immobiles, mornes, qui faisaient des petits pas retenus, ondulaient sur place, lançaient parfois un pied de côté, comme en un de ces gestes convulsifs qu’on fait dans les songes …
Mais cela ne les réveillait pas. Ils continuaient à piétiner avec une tranquille somnolence, une impassibilité d’hypnotisés ou de somnambules. On les aurait crus en léthargie, si les visages des danseurs de tango n’eussent offert tous une même expression d’opiniâtreté triste, un air attentif, crispé, tourmenté de scrupules, travaillé par cette sorte d’angoisse qu’on voit aux jeunes gens lorsqu’ils passent leur examen de baccalauréat.
Telles sont les danses vives et les danses lentes admises dans la société.
Je crois avoir assez clairement exprimé les sentiments qu’elles inspirent à quelqu’un qui est soucieux de bonne tenue.
Paul Reboux (1930)
(paru dans le Canard Folk de février 2010)

