Danser dans la France des Lumières
par Sylvie Granger (425 pages – Presses universitaires de Rennes, 2019)
C’est la découverte d’un mystérieux carnet qui nous lance sur la piste d’un maître à danser des années 1760, de Mademoiselle sa fille et de leur entourage. Un carnet de danseur dans lequel il recopiait ou collait des feuillets contenant les explications des contredanses apprises qu’il devait, par la suite, utiliser comme aide-mémoire.
Ce carnet conduit forcément au maître à danser le plus en vue à Orléans, en l’occurrence, Jean Robert, fil rouge et héros de cet ouvrage. A partir d’Orléans, Sylvie enquête dans d’autres villes sur le métier de maître à danser. Ses recherches la mèneront principalement dans des villes du quart nord-ouest de la France comme Laval, Brest, Le Mans, Lille, Chartres et bien d’autres, mais aussi à Nevers, Lyon, Nancy, Marseille ou Bordeaux.
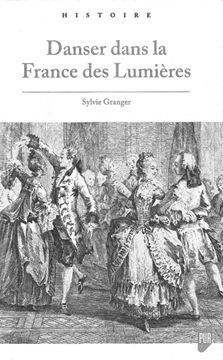
Cédons la parole à Sylvie Granger qui, dans sa conclusion, nous résume la vie de Robert : « L’apogée orléanais de Jean Robert se place au cours des années 1760. Ce sont les années où, implanté au cœur d’Orléans, au bord de ce Martroi, épicentre de la vie active, il rayonne à plusieurs échelles. Homme clé de la danse orléanaise, il enseigne menuets, allemandes et contredanses à la jeunesse de la ville – tant aux bons garçons qu’aux demoiselles –, il dynamise la Société des symphonistes (musiciens) associés, organise, annonce et anime des bals, tient la dragée haute aux comédiens. Tout cela en faisant sa cour à Mme l’intendante, et peut-être en accédant par son entremise à la clientèle huppée qui gravite autour d’elle. La spécificité de Jean Robert par rapport à ses confrères des autres villes des provinces, c’est qu’il est reconnu bien au-delà des divers cercles orléanais. Grâce à la publication d’au moins quatorze de ses compositions dans les feuilles de danses parisiennes en 1762 et 1763 – et peut-être déjà un peu plus tôt –, il accède à une notoriété qui s’épanouit potentiellement à l’échelle nationale – voire au-delà des frontières, la danse française étant goûtée partout en Europe, comme dans les habitations des Isles et des Amériques. Chaque semaine ou presque, Robert court à la poste récupérer la lettre envoyée de Paris par le Sieur Delacuisse contenant la dernière contredanse sélectionnée, il la découvre, l’expérimente puis en « conduit la gravure », peut-être gravant lui-même les plaques de cuivre qui seront ensuite confiées à l’imprimeur ».
Au cours des 425 pages que comprend cet ouvrage, Sylvie Granger se base sur des affiches, des manuscrits, des carnets, des feuilles volantes expliquant le déroulement des danses ; nous apprenons ce qu’est la vie d’un maître à danser de cette fin de l’Ancien Régime. Un maître à danser qui souhaitait s’établir dans une ville devait obtenir une licence de la part des autorités policières. Il devait ensuite se procurer un local assez vaste, soit en le louant, soit en en faisant l’acquisition. Il devait ensuite soigner sa publicité (affiches, feuilles volantes, enseignes, bouche à oreille). Il pouvait donner des cours de danses à des groupes de jeunes bourgeoises et bourgeois, mais pouvait aussi se rendre au domicile d’élèves plus fortunés qui pouvaient se permettre un professeur individuel. Il faut dire que la danse faisait partie intégrante de l’éducation des jeunes bourgeois avec l’équitation et l’escrime, pour les garçons et la musique ou le chant et les travaux de dames pour les demoiselles. Les maîtres à danser se devaient d’enseigner le maintien, les bonnes manières, l’art de se,comporter en société à leurs élèves. C’était aussi un moyen de développer son corps et de soigner sa prestance. L’apprentissage de la danse était si important que les collèges, surtout des jésuites l’avaient inclus dans le programme scolaire.
Les maîtres à danser organisaient ou animaient des bals. Ceux-ci avaient lieu jusqu’à trois fois par semaine dans des villes de moyenne importance. Généralement, les bals débutaient à 17 heures pour se terminer à 21 heures. On y dansait « la belle danse » principalement le menuet, mais surtout la contredanse venue d’Angleterre au début du siècle. Les contredanses anglaises se dansaient en colonnes, homme et femmes se faisant face effectuant des figures jusqu’au moment où le second couple pouvait commencer sa prestation.
L’avantage des « English Country Dances » est qu’elles étaient ouvertes « for as many as will », c’est-à-dire pour autant (de couples) qu’on souhaite. Plus tard la France inventa la contredanse française avec les couples (le plus souvent quatre) placés sur les quatre côtés d’un carré. Il y avait une interaction entre les danseurs, des figures parfois très compliquées, les pas étant de moindre importante dans ce genre de danse. Jean-Michel Guilcher : « la contredanse est une danse à figures, qui fait se rencontrer des individus et des couples. On se sépare, on se retrouve, se croise et se quitte ». Les bals donc étaient principalement organisés entre octobre et le carnaval. Il y a avait un arrêt durant la période du carême, puis en été, les riches aristocrates partaient « en vacance », c’est-à-dire se rendaient dans leur propriété ou leur château de la campagne où ils pouvaient diriger les activités de la ferme et surveiller les moissons. Il n’était cependant pas rare que des maîtres à danser soient engagés par une riche famille et invités à l’accompagner dans leur résidence d’été pour y donner des leçons de danse et animer les soirées.
C’est peut-être durant ces semaines d’été que les milieux populaires ont été en contact avec la contredanse. Citons une nouvelle fois Sylvie Granger : « Lorsque Monsieur de la Cabriolle (ou n’importe lequel de ses confrères) est en séjour au château, il apporte au cœur de la campagne des manières issues de la dernière – ou avant-dernière… – mode des salons. Quand il joue du violon sur les terrasses et dans les jardins, les oreilles des environs retiennent ces airs nouveaux et des archets plus rustiques que le sien les expérimentent le dimanche suivant … Quand il fait répéter les figures d’une contredanse à la jeunesse de la famille, il est observé de loin, notamment par le personnel de maison, intermédiaire culturel s’il en est, mais aussi par tous ceux qui ont accès au château (voituriers, jardiniers,lingères, fournisseurs divers …). Cela n’est sans doute pas vrai partout : on ne peut accepter et adopter que ce qu’on est prêt à recevoir et certains milieux ruraux sont probablement restés indifférents, et par là même hermétiques, aux musiques et aux danses étranges de ces Messieurs. En revanche, dans les régions les plus ouvertes aux influences extérieures, et dans celles où les densités de noblesse résidente sont les plus fortes, ces migrations temporaires d’innombrables maîtres à danser ont probablement contribué au grand mouvement de basculement des milieux ruraux de la danse en rond vers la contredanse qu’on qu’on discerne au cours de la secondemoitié du XVIIIe siècle ».
Ce qu’il est frappant de constater est que le métier de maître à danser était très répandu. Une ville comme Orléans en comptait plusieurs. Je pense que nous pouvons extrapoler ces données et supposer qu’il en était de même chez nous. De cette époque, nous connaissons Wandembrile à Namur, Trappeniers à Bruxelles, d’Aubat Saint-Flour à Gand, l’Echo, Buchard, Benoît & Andrez à Liège. Tous ces musiciens nous ont laissé des dizaines de contredanses tant anglaises que françaises. La revue l’Écho parut à Liège entre 1758 et 1773 offrant son lot de contredanses surtout issues d’Angleterre. Mais à côté de ces manuscrits et publications, combien de maîtres à danser sont tombés dans l’oubli ? Soit parce que leurs carnets ont disparu ou été détruits, soit qu’ils ne prenaient pas la peine de nous léguer leur savoir ou, tout simplement, qu’ils apprenaient de routine et jouaient d’oreille. On peut donc supposer que dans les grandes villes de notre pays officiaient des maîtres à danser tant pour l’éducation de la jeunesse que pour l’organisation et l’animation de bals privés et publics.
Nos régions rurales vont, elles aussi, adopter la contredanse en la transformant et en y insérant des éléments de danses locales plus anciennes. Elles se maintiendront jusqu’au milieu du XIXe siècle avant de céder la place aux quadrilles et aux danses en couples fermés. Elles sont nombreuses dans les manuscrits de cette époque, principalement François-Joseph Jamin de Meix-devant-Virton et Jean-Guillaume Houssa de Wy à une vingtaine de kilomètres à l’est de Marche-en-Famenne.

Un livre passionnant, d’une lecture aisée, truffé d’informations, d’exemples et d’anecdotes. Un livre qui nous fait pénétrer dans le monde de la danse au Sièclevdes Lumières, mais aussi une immersion dans la vies sociale très particulière des dernières dizaines d’années avant la Révolution.
Sylvie Granger est historienne et chercheuse. Elle travaille sur les sociétés provinciales du XVIIIe siècle, urbaines (Journal d’un chanoine du Mans, PUR 2013) ou villageoises (Souvenirs d’un villageois du Maine, PUR, 2016). Elle s’attache à faire surgir de l’ombre les musiciennes méconnues (Musiciennes en duo, PUR,
2015).
Une interview de Sylvie Granger (une quinzaine de minutes) est disponible sur Internet. Il vous suffit de « googler » « Sylvie Granger – Danser dans la France des Lumières ».
Rappelons également que l’ouvrage de référence en matière de contredanse française est « La contredanse – Un tournant dans l’histoire française de la danse » – Jean-Michel Guilcher – 233 pages – Éditions complexes et Centre national de la danse (2003).
Jean-Pierre Wilmotte
(article paru dans le Canard Folk d’octobre 2021)

